S’il est un cinéaste américain dont l’œuvre cinématographique peut être associée au cinéma africain d’aujourd’hui, c’est bien lui. Et la Cinémathèque québécoise ne s’y est pas trompée en offrant au Festival Vues d’Afrique pour son 25ème anniversaire la projection de la quasi-intégralité de ses films.

Spike Lee, cinéaste afro-américain de 52 ans, propose depuis près d’un quart de siècle un cinéma qui dérange, qui secoue, qui égratigne « l’American way of life ». Un cinéma qui se veut réaliste, dans le sens premier du terme : montrer la réalité de son pays, filmer la complexité des êtres, les inégalités sociales et raciales, l’injustice aux États-Unis. Ainsi l’œuvre de Spike Lee, en tant que cinéma social, engagé, polémique peut être comparée à celle de certains réalisateurs du continent noir, tels le défunt Sénégalais Ousmane Sembene, le Burkinabé Idrissa Ouédraogo, ou encore plus récemment le Mauritanien Abderrahmane Cissako.
Spike Lee, un cinéaste engagé malgré lui
Né à Atlanta, Géorgie, d’une mère institutrice et d’un père jazzman, Shelton Jakson Lee a grandi à New York, à Brooklyn, et la Grosse Pomme est vite devenue son lieu de tournage de prédilection. De là, un cinéma très urbain, filmant souvent la rue, sa violence, ses communautés. Diplômé de la New York University’s Film School, Spike Lee commence à tourner des courts-métrages dans les années 1980. En 1986, son premier long métrage She’s gotta have it est un franc succès et décroche le Prix de la Jeunesse au Festival de Cannes. Spike Lee devient célèbre, il est vu comme le « Woody Allen noir » en raison de sa ville d’origine, New York, et de la pointe d’humour avec laquelle il parle de la liberté sexuelle des femmes et aborde la sexualité des noirs dans ce film.
Par la suite, reconnus ou non par la critique, ses films vont déranger, troubler, remuer… Remuer le passé raciste américain, son actualité : Do The right thing (1989) s’inspire d’un fait réel, la mort d’un jeune noir, victime de la brutalité policière. Loin de répondre à la vision manichéenne qu’en offre Hollywood, les films de Spike Lee ne donnent pas de réponse, mais introduisent le débat. « Je ne me considère pas comme un militant, quelqu’un qui cherche la controverse. Je ne suis ni Malcolm X, ni Che Guevara. Je veux juste faire des films qui font réfléchir. » a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a précédé le lancement de sa rétrospective mercredi 8 avril. De ses plus gros succès commerciaux (Malcolm X, 1991, Inside Man, 2006) à ses documentaires (4 Little Girls, 1997, When the Levees Broke, 2006), en passant par ses envolées poétiques (Mo’Better Blues, 1990), Spike Lee crée dans le temps une œuvre à part, qui, qu’il le veuille ou non, est engagée, politiquement, esthétiquement, philosophiquement.

Il est d’ailleurs un des rares cinéastes américains à être invités sur les plateaux de télévision pour parler de politique. La présence de nombreux jeunes noirs, canadiens et étrangers, le soir de la projection de son dernier film Miracle à Santa Ana (2008) à la Cinémathèque québécoise, mercredi 8 avril, leurs questions liées à l’identité noire aux États-Unis, les inégalités nord-sud, la récente révolte des Antilles françaises, prouvent une fois de plus que la voix de Spike Lee porte au-delà des frontières cinématographiques, au-delà de son propre continent. Spike Lee est bien un artiste militant.
Rétrospective Spike Lee du 8 au 26 avril.






























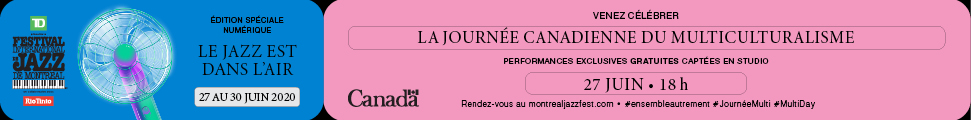












Spike Lee, j’espère qu’on le verra chez nous en Afrique un jour tout de même!