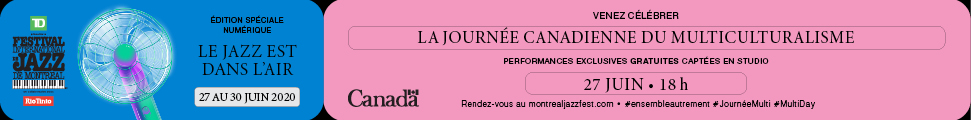Christophe Edimo, le Président de l’association l’Afrique dessinée était de passage au festival pour dédicacer l’album qu’il a scénarisé, « Malamine, un Africain à Paris ». Touki Montréal en a profité pour lui poser quelques questions sur les origines et les voies qu’empruntent la BD africaine.
Comment débute l’histoire?

Par la colonisation. Ce sont les missionnaires qui ont amené la BD au Congo belge dès les années 1920. Une production essentiellement religieuse a commencé, ils dessinaient des histoires bibliques.
À la fin des années 1940, des Congolais s’y sont mis, mais c’était encore à des fins religieuses. Ils ont commencé à dessiner le quotidien à partir des années 1960 au Congo belge, devenu Congo-Kinshasa et République démocratique du Congo. C’est là où il y a le plus de dessinateurs, une centaine. Ils parlent de maladies, des difficultés du quotidien et c’est généralement financé par des ONG.
Après il y a les fanzines, de plus en plus en langue lingala. Ils se sont approprié la BD au niveau de la narration là-bas. Par contre, au niveau graphique, ça reste des codes franco-belges. Il y en a très peu qui se lâchent et utilisent l’art plastique africain.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur eux?

Je connais Armella Leung-Oswald, une sino-malgache qui utilise l’art africain. C’est aussi le cas d’un Camerounais du nord, Japhet Myagotar. Il se sert de tout ce qui provient du masque. Ça leur donne une expression graphique très originale et africaine. À part ces deux-là, je ne connais personne qui le fasse.
Mais bon, ce n’est pas un reproche. Il faut s’approprier un art qui est occidental à la base. Et ce qui se fait, c’est déjà pas mal. Ce qui est important pour moi, c’est qu’il y ait un véritable public friand de BD qui a été élevé dans la caricature de presse. Il vient naturellement vers le dessin et l’art plastique. La structure narrative de la BD est proche de celle du conte. Même si l’oralité se perd, le conte subsiste.
La BD accompagne ou succède au conte, je ne sais pas ce qui va se produire. Mais en tout cas, elle ne déstabilise pas le public. Elle a sa place.
Pourquoi l’industrie peine à se développer si la demande est là?
 Le problème c’est qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent. Lors du festival de BD de Bamako au Mali, les pères et mères de familles amènent les enfants. Ils sont plusieurs milliers à feuilleter la BD occidentale.
Le problème c’est qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent. Lors du festival de BD de Bamako au Mali, les pères et mères de familles amènent les enfants. Ils sont plusieurs milliers à feuilleter la BD occidentale.
Mais la production locale est très faible. Il y a 4 ou 5 auteurs. Le prix de l’impression est très élevé et les conditions de distribution très modestes. Ce sont des freins qu’on retrouve un peu partout en Afrique : Cameroun, Cote d’Ivoire, Congo et même à Madagascar où il y a eu un âge d’or de la BD pendant 10 ans, après le départ de Didier Ratsiraka [NDRL : Président de la République de Madagascar (1975-1993 et 1997-2002) surnommé « l’Amiral rouge »]. Mais avec la crise économique, ça s’est de nouveau effondré.
Alors, les auteurs espèrent surtout avoir une place de caricaturiste dans un journal. Mais le nombre de titres est très faible. Il y a un cas particulier en Côte d’Ivoire, la publication Gbich ! composée à 80 % de BD. L’actualité y est dessinée.
Un de ses personnages a été dérivé en série télé : Cauphy Gombo. Il est représentatif des Ivoiriens. Cauphy Gombo vit au jour le jour dans une société très mercantile, pleine de corruption et d’abus de pouvoir. Il exprime le génie de la survie au quotidien.
Au Cameroun j’ai un copain qui essaie de créer un journal aussi à 80% dessiné. Le lectorat est là, mais il a des difficultés économiques.