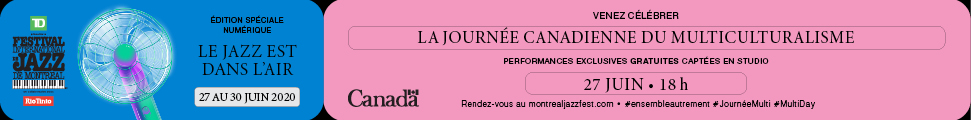En 1949, sortait «1984», roman d’anticipation qui allait devenir un livre-culte pour plusieurs générations. Le Britannique George Orwell y décrivait un monde totalitaire en Angsoc, pays fictif où chaque parcelle de vie était contrôlée par les disciples du grand maître Big Brother. Le système stalinien était clairement visé. Aujourd’hui encore, la Corée du Nord et certains anciens territoires soviétiques peuvent en partie faire penser à cette description visionnaire.
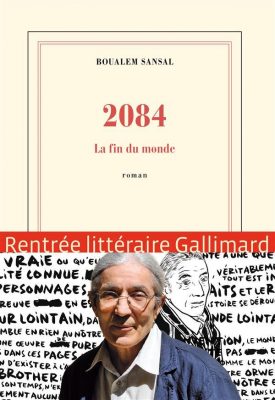 Avec «2084. La fin du monde», l’Algérien Boualem Sansal reprend brillamment le procédé orwellien en l’appliquant au monde musulman. À cette époque, en Abistan, l’ancien monde n’existe plus.
Avec «2084. La fin du monde», l’Algérien Boualem Sansal reprend brillamment le procédé orwellien en l’appliquant au monde musulman. À cette époque, en Abistan, l’ancien monde n’existe plus.
Les meubles, internet, l’art, les vestiges architecturaux marqueurs de temps, la notion d’individu ont disparu de la vie quotidienne, noyés par la tyrannie du Gkabul, nouveau livre sacré où le Dieu s’appelle Yölah et son représentant parmi les hommes Abi, alias Bigaye.
Le peuple, réduit à l’état de moutons sans réflexion, obéit à toutes les règles de la terreur, même les plus scélérates ; dénoncer ses amis, frapper les femmes, assister avec joie aux innombrables exécutions dans les stades. En lisant le récit angoissant de Sansal, nous, observateurs de 2016, imaginons les Talibans, les Frères musulmans ou l’État islamique avoir définitivement triomphé de la liberté. Sansal croit-il vraiment que tel est le futur probable du monde musulman? Son récit nous paraît quoi qu’il en soit une hypothèse plausible. C’est bien là la tragédie.
Voilà pourtant qu’Ati, pauvre tuberculeux pas particulièrement éclairé, se met à douter. Éloigné de la chape de plomb du quotidien à cause de la maladie, il «franchi[t] la ligne rouge», réfléchissant à la crédibilité du message de Abi et de ses sbires. Il se met à être «convaincu que l’homme n’exist[e] que dans la révolte et par la révolte» et aspire à un rêve fou: la quête d’une certaine forme de vérité empreinte de liberté.


Il serait réducteur de ne voir dans «2084» un 1984 adapté. Le livre de Sansal est une véritable œuvre littéraire, où le style offre des moments de grâce, renforçant des idées percutantes aussi actuelles qu’essentielles. L’Académie française ne s’y est pas trompée en accordant son «Grand Prix du roman» à l’écrivain maghrébin en 2015.