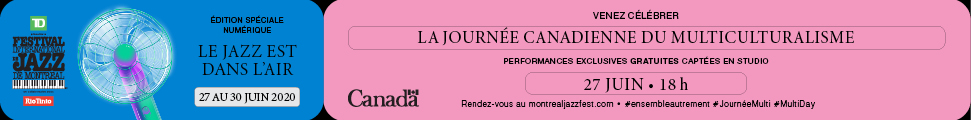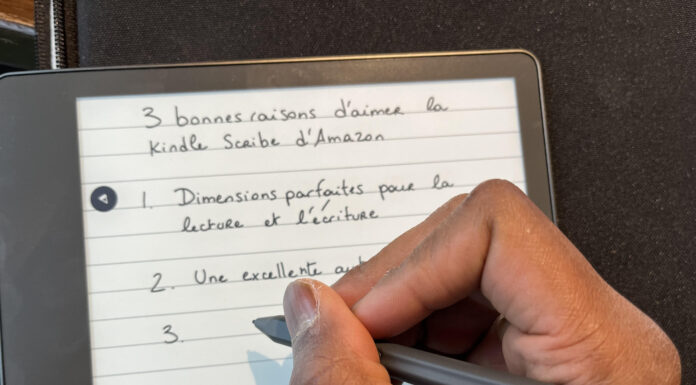Au début du mois de juin, Touki Montréal a assisté au festival de musique Sakifo, à la Réunion. On en a profité pour rencontrer des musiciens de cette petite île française de l’océan Indien pour qu’ils nous parlent du maloya, cette musique réunionnaise inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Qu’est-ce que le maloya?
Le maloya est l’une des deux musiques emblématiques de l’île de la Réunion (l’autre étant le séga). Les instruments traditionnellement utilisés sont le roulèr (un gros tambour), le kayamb (une sorte de hochet rectangulaire qu’on secoue avec les deux mains), le sati (petit instrument en fer qu’on frappe à l’aide d’une baguette) et le bobre (un instrument en forme d’arc, cousin du bérimbau brésilien, instrument principal de la capoeira).
Voir cette capsule vidéo sur les instruments traditionnels du maloya: https://youtu.be/qhz5eT9bRus

Né dans les plantations sucrières pendant la traite esclavagiste, le maloya est une musique réunissant chant et danse, aux rythmiques tantôt endiablées, tantôt lancinantes.
«C’est la musique des classes populaires, des descendants d’esclaves et d’engagés qui vouaient un culte aux ancêtres», explique Stéphane Grondin, historien du maloya et leader de Mélanz Nasyon, l’un des groupes phares de ce style musical à l’île de la Réunion.
Cette musique, longtemps mal vue, était, par le passé, interdite dans les espaces publics et sur les ondes réunionnaises. «Pas de façon légale, plutôt sous la forme d’une censure tacite», rappelle M. Grondin.
La raison? «Parce que, dans les années 1970, il a été très fortement politisé par le PCR [Parti communiste réunionnais]. (…) Le maloya a été pris dans un étau politique. Les musiciens qui en jouaient ont été les faire-valoirs des politiciens», souligne le musicien de 37 ans, également auteur de l’ouvrage «Aux Rythmes du Maloya», une nouvelle référence dans le domaine.
Malgré cet embrigadement à forte saveur politique, le maloya a fait son petit bonhomme de chemin en devenant, au fil des ans, un véritable outil d’affirmation de l’identité réunionnaise. Il a même été inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2009, soulevant au passage de vives réactions de la part des défenseurs du séga qui regrettaient qu’une seule des deux musiques endémiques de l’île ne soit reconnue par l’Unesco.

«Pour nous, le maloya c’est la musique de nos racines, de nos ancêtres. C’est un mélange de plusieurs cultures. Il nous permet d’exprimer ce que nous avons au fond de nous», explique Guillaume Sapra, 32 ans, leader du très jeune groupe Gadiembe Maloya, formé en 2014. «Le maloya, c’est ce qui nous représente, les Réunionnais. Il est ancré dans chaque personne, dans chaque famille», d’ajouter Karine Caye, choriste du groupe.
Une musique qui se métisse
Autrefois joué dans des cadres plutôt intimes comme les kabars ou les «servis kabaré» [fêtes réunionnaises dans lesquelles on joue du maloya pour rendre hommage aux ancêtres], le maloya s’invite, depuis sa démocratisation, dans les années 1980, sur scène, sur les plateaux de télévision, à la radio, à la Réunion, mais aussi à l’extérieur de l’île. Des vétérans comme Danyel Waro, le groupe Ziskakan ou encore Lindigo sont de fiers ambassadeurs du maloya à l’étranger.
Avec le temps, comme toute autre musique, le maloya s’est métissé avec d’autres genres musicaux comme le rock, le jazz, le blues, le reggae [la fusion du maloya et du reggae, appelé malogué a été très populaire dans les années 1990] ou encore les musiques africaines.
Le groupe Grèn Semé, formé dans le courant des années 2000 et mené par Carlo de Sacco, porte fièrement le drapeau d’un maloya «évolutif», aux influences diverses comme le jazz, l’électro et les musiques du monde.

««Évolutif» veut dire que nous sommes en recherche perpétuelle de sons, de textures, de façons de nous amuser avec le maloya. Ce qu’on aime, c’est de transgresser et de briser les codes établis. (…) Nous faisons ce qui nous éclatent, peu importe ce que les gens peuvent dire», raconte le chanteur et compositeur de Grèn Sémé, qui n’hésite pas à jongler entre le français et le créole sur ses disques.
S’il y a bien une autre artiste réunionnaise qui brandit bien haut les couleurs d’un maloya métissé et moderne, c’est bien Nathalie Natiembé, une vétérante de cette musique réunionnaise.
À 60 ans, celle qu’on appelle la «punkette du maloya» a une carrière professionnelle de près de 20 ans à son actif. Elle fait «son» maloya comme elle le dit si bien, greffant au passage une multitude d’influences à sa musique: du rock, de la variété française, du reggae… Elle ne veut s’enfermer dans aucune case.
«Le maloya est une musique de liberté. Chaque artiste décide d’emprunter le chemin qu’il ou elle veut. Personnellement, j’ai déjà fait du traditionnel et je n’ai vraiment pas envie d’être coincée dans un seul style de musique. Je suis une femme très curieuse et c’est ce trait de caractère qui fait en sorte que j’ai envie d’explorer divers horizons musicalement», a-t-elle expliqué à Touki Montréal en marge du festival Sakifo.

Le maloya: un monde d’hommes
Le milieu du maloya est très patriarcal, admet Nathalie Natiembé. «On y voit très peu de femmes. Mais il faut rappeler qu’elles ont un très grand rôle dans la tradition du maloya. Dans les «servis kabaré», ce sont les femmes qui s’occupaient de tout pour accueillir les gens. (…) Pour moi, le maloya est une femme. Une femme cafrine [NDLR: de descendance africaine] bien faite, tout en rondeurs comme le roulèr [NDLR: l’un des instruments essentiels du maloya].»
Quelques femmes de talent y ont néanmoins fait leurs marques. En plus de Nathalie Natiembé, on peut citer Françoise Guimbert, une légende vivante du maloya, Christine Salem, meneuse du groupe Salem Tradition, le groupe Simangavoledont l’album «Fanm i dobout» [NDLR: les femmes se tiennent debout] sorti en 2013 était fait «par des femmes pour des femmes».
C’est sans oublier la jeune Maya Pounia, auteure-compositrice-interprète qui est à la tête du groupe Maya Kamaty, qui écume les festivals autour du monde pour faire connaître son maloya 2.0.
Le maloya traditionnel se perd-il?

Métissage oblige, une question se pose: est-ce que le maloya dit «traditionnel» est en train de mourir à petit feu? «Oui, répond sans hésiter Guillaume Sapra, du groupe Gadiembe Maloya. Le maloya se perd un peu, surtout avec tous les styles de musiques qui arrivent de plus en plus à la Réunion. (…) Certains d’entre-nous devons le préserver.»
Karine Caye, la choriste du groupe, abonde dans le même sens. «Ce n’est pas toujours facile de mettre cette musique de l’avant, parce que nous-mêmes les Réunionnais, nous avons tendance à la prendre pour acquise. Par contre, traditionnel ou moderne, il y a plusieurs façons de faire du maloya.»
Bernard Joron, du groupe Ousanousava, bien connu dans l’île, lance de son côté que certains signes pourraient nous laisser croire que le maloya se perd. «Aujourd’hui, il y a de moins en moins de musiciens qui en jouent en «live», «dan bor chemin» [NDLR: dans la rue], contrairement à avant», regrette-t-il.
Le musicien de 52 ans équilibre néanmoins ses propos en ajoutant que d’un autre côté, d’autres signes prouvent que le maloya est bien enraciné. «Il y a des groupes locaux qui portent bien haut les couleurs du maloya, ici comme à l’étranger. Sans oublier l’intérêt grandissant que cette musique suscite auprès de musiciens qui viennent d’ailleurs», se réjouit-il.
Pour Nathalie Natiembé, pour qui le métissage fait partie de son ADN musical, les influences musicales venues d’ailleurs apportent de la richesse au maloya. «Ce n’est pas une perte, bien au contraire», s’exclame la musicienne.
Une cassure du lien intergénérationnel
Stéphane Grondin, l’historien du maloya, pense quant à lui que le lien intergénérationnel s’est perdu entre les «gramounes» [NDLR: les aînés] et les musiciens de la nouvelle génération. «Beaucoup de vétérans du maloya n’ont pas forcément eu l’occasion de transmettre leur savoir-faire, tout comme certains jeunes qui en jouent maintenant ne vont pas à la rencontre de ceux qui ont porté cette musique avant eux», regrette-t-il.
Tous les musiciens interrogés, sans exception, ne voient toutefois pas l’évolution du maloya d’un mauvais oeil. «Avec la modernité, on n’a pas le choix d’évoluer, de faire des choses différentes, mais il ne faut pas perdre non plus le traditionnel», revendique Guillaume Sapra.
Même son de cloche du côté de Bernard Joron. «Qu’on le veuille ou non, la musique évolue. Le maloya qu’on joue aujourd’hui n’est plus celui qu’on jouait auparavant dans les plantations. (…) De toute façon, la mondialisation et l’interdépendance entre les pays nous obligent aujourd’hui à être ouverts sur le monde. Je trouve ça dommage de rester cloisonnés dans un seul modèle de pensée. Mais les puristes ont bien le droit de vouloir préserver le maloya tel qu’il est», conclut-il.
Lindigo: https://youtu.be/Y_M543zjGT0
Christine Salem au Tiny Desk de la chaîne publique américaine NPR: https://youtu.be/b2Eylm6_9_w
Quelques photos du festival:
Photos: John Nais, Touki Montréal