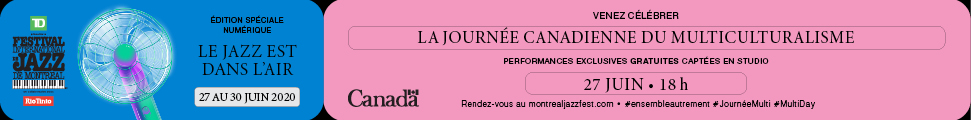À l’occasion de la sortie du documentaire « Ouvrir la voix » au Québec, dans lequel 24 jeunes femmes noires racontent leurs expériences de vie en France et en Belgique, Touki Montréal s’est entretenu avec Amandine Gay, la réalisatrice du long métrage.
À l’occasion de la sortie du documentaire « Ouvrir la voix » au Québec, dans lequel 24 jeunes femmes noires racontent leurs expériences de vie en France et en Belgique, Touki Montréal s’est entretenu avec Amandine Gay, la réalisatrice du long métrage.
À qui s’adresse votre documentaire?
Ce film s’adresse à tout le monde, mais ce sont les jeunes filles noires que j’avais en tête quand je l’ai réalisé. Il fait écho à leurs propres réalités. J’espère qu’il pourra leur donner des outils pour plus tard.
C’est un film que j’aurais aimé voir quand j’étais plus jeune. Le but est également de leur montrer que tous les choix sont légitimes et valides. Leur montrer qu’on peut être une femme noire et lesbienne. Qu’elles ont le droit d’être déprimées. Je voulais en quelque sorte ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles noires, voire être une source d’inspiration. Et pourquoi pas inspirer des jeunes filles à devenir réalisatrices?
Qu’est-ce qui vous a motivée à faire ce film?
J’ai toujours voulu faire un film. J’ai toujours aimé écrire. J’ai toujours voulu raconter mes propres histoires. Les thèmes du documentaire sont basés sur ma propre histoire. Les femmes noires sont amenées très tôt dans leur vie à se questionner sur elles-mêmes, sur leurs identités.
Quand on n’appartient pas à la norme, on nous le fait très vite savoir, très souvent dans le rejet. De l’autre côté, est-ce que les personnes blanches s’interrogent sur leur identité? Est-ce que les Blancs ont conscience qu’ils sont blancs? Qu’ils sont privilégiés? Je voulais en quelque sorte questionner la norme. Je voulais montrer des femmes noires telles que moi je les vois au quotidien. Des femmes noires que je ne vois pas dans le paysage audiovisuel français.
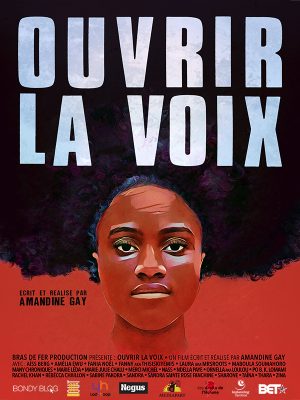 Vous trouvez qu’il n’y a pas suffisamment de diversité dans le traitement de la femme noire à l’écran en France?
Vous trouvez qu’il n’y a pas suffisamment de diversité dans le traitement de la femme noire à l’écran en France?
Quand j’étais comédienne, on me proposait beaucoup de rôles extrêmement stéréotypés. Au bout d’un moment, ça m’a gâché le plaisir de jouer. En plus, c’était devenu compliqué pour moi, dans mon travail alimentaire [d’actrice], de renforcer des clichés que j’essayais de déconstruire dans mon travail de recherche, de militante et de créatrice.
Ça devenait très pénible d’aller passer des castings pour ce genre de rôles qui manquent clairement d’originalité. On me demandait souvent de parler avec un accent africain ou antillais. Accents que je n’ai pas. Quand c’est une fois de temps en temps, on peut se dire pourquoi pas. Mais quand c’est systématique, ça devient lassant à la longue.
Vous regrettez donc un manque de complexité dans les rôles que vous deviez jouer?
Exactement. Dans le cinéma français, les personnages noirs sont très rarement complexes. Le gros de leur identité peut être résumé au fait qu’ils sont Noir.es. Être Noir.e, ce n’est aucunement un trait de personnalité. Sans oublier que ce sont des rôles souvent liés à des histoires de migrations tragiques, comme le mariage forcé ou les mutilations génitales féminines.
Sinon, ce sont des histoires de banlieues avec des problématiques liées à la drogue, au travail du sexe, à la prison… Il est difficile pour les Noir.es d’avoir ce que j’appelle le « droit à la banalité », c’est-à-dire le droit d’être comme tout le monde.
Vous parlez souvent de décoloniser les esprits. Que voulez-vous dire exactement?
Le groupe majoritaire, c’est-à-dire les personnes blanches, doit être capable de sortir de l’idée que l’universel est blanc. Est-ce que ces personnes sont capables de voir autre chose que des Noir.es lorsqu’elles voient un film avec des personnes noires? On dit souvent que les films avec des acteurs et actrices noir.es sont des « films de noirs », des « films de niche ».
Moi, en tant que femme noire, je peux regarder des films avec uniquement des Blancs et je peux voir que c’est une histoire d’amour, un drame familial… Je suis tout à fait capable de voir leur humanité. Pourquoi l’inverse ne serait pas possible? Pourquoi les personnes blanches ne seraient pas capables de voir un film avec uniquement des Noir.es comme une comédie, un film d’amour, un drame? Quand je parle de décolonisation de l’esprit, c’est tout simplement la capacité de nous voir comme des êtres humains à part entière.
Pensez-vous que la situation pourrait changer un jour?
Dans l’absolu, j’ai beaucoup de mal à me positionner comme étant pessimiste ou optimiste. Je suis quelqu’un qui lutte. Je pense que les choses peuvent changer, mais qu’il faut se battre pour qu’elles changent.
Est-ce qu’elles vont réellement changer? Là, c’est autre chose. Mais j’ai clairement décidé de me battre pour que les choses s’améliorent.
Vous vous présentez comme une afroféministe. Quelle est votre vision de l’afroféminisme?
Pour moi, c’est la possibilité de faire coexister toutes mes identités. Je n’ai pas à choisir entre le fait d’être une femme, d’être noire, d’être pansexuelle, d’être adoptée… Ce qui m’intéresse, c’est de trouver des outils pour pouvoir lutter à partir de toutes mes identités.
Dans votre film, vous abordez le sujet de la « race ». Pourquoi ce terme est-il si sensible en France selon vous?
Il n’y a jamais eu de travail de déconstruction scientifique du terme « race » en France. Scientifique dans le sens sociologique. Dans le monde anglo-saxon, il y a eu des disciplines comme les « critical race theories » ou les « cultural studies » qui s’y sont intéressées. Ce qui n’a pas été le cas en France. On n’a pas eu les outils nécessaires pour déconstruire cette notion.
Le mot « race » a été utilisé en France à partir du 18e siècle pour établir une hiérarchie biologique entre les êtres humains. Mais on le sait bien que, biologiquement parlant, il n’existe pas plusieurs « races ». Le mot race est une construction sociale.
Dans la société française, il existe des traitements différenciés qui sont liés au fait qu’on est assigné.e à une « race » donnée. Être Noir.e, c’est une construction sociale. Et historiquement il y a eu des caractéristiques sociales et des stéréotypes qui y ont été associés. Au lieu de vouloir effacer ce mot, on devrait être capables de se l’approprier et l’utiliser pour pouvoir expliquer ce qu’il nous arrive dans notre quotidien.
La France devrait donc s’inspirer de ce qui se fait ailleurs?
En effet. La société française n’est pas aussi pragmatique que les sociétés anglo-saxonnes. Au contraire, elle privilégie beaucoup l’idéologie. Les personnes [racisées] qui subissent les discriminations au quotidien sont beaucoup plus dans le pratico-pratique.
Elles veulent savoir comment ne pas être victime de profilage racial, comment ne pas se faire harceler par la police, comment trouver un emploi ou un logement… Alors qu’en face, les gens qui ne vivent pas ces discriminations vont avoir des réponses théoriques du genre « nous sommes tous des êtres humains ».
Mais dans la pratique, ce n’est pas ce qui se passe. Ceux qui ne sont pas traités comme des êtres humains à part entière, la théorie ne leur est pas d’un très grand support.
L’expérience des femmes noires en France et au Québec est-elle similaire et transposable?
Pas vraiment. Les parties du film qui abordent l’image de soi et le rapport à l’enfance semblent être universelles. La plupart des femmes noires, qu’elles vivent en France, au Québec ou en Allemagne, peuvent s’y reconnaître.
La discrimination à l’orientation scolaire semble également être un vrai sujet au Québec. Mais il y a des aspects qui diffèrent totalement, notamment tout ce qui touche la notion de communautarisme qui n’a pas du tout la même signification en France et au Québec.