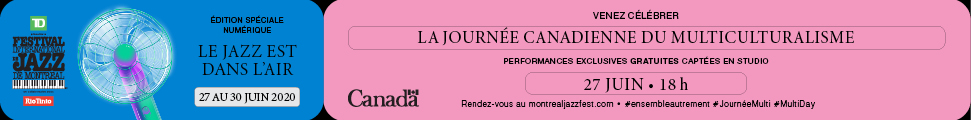C’est l’histoire d’un exploit sportif bouleversant. Le 10 septembre 1960, l’Éthiopien Abebe Bikila devient champion olympique du marathon à Rome. Le chronomètre affole les experts de l’époque : 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, soit un nouveau record du monde. Il y a plus important encore : jamais un athlète de l’Afrique noire n’a remporté la médaille d’or aux JO. Il y aura un avant et après Bikila.
Pour revenir sur ce moment extraordinaire, Sylvain Coher a choisi le monologue intérieur fictif. Il plonge son lecteur dans le cerveau du jeune caporal éthiopien tout au long de son parcours doré long de 42,195 kilomètres. Un marathon que le dossard 11, loin d’être favori au départ, court… pieds nus, particularité qui fera beaucoup pour sa renommée mondiale.
Le romancier français dessine un homme humble, mais sûr de sa victoire. « Tchigri yellem. Il n’y a pas de problème », se répète Abebe Bikila, tel un credo.
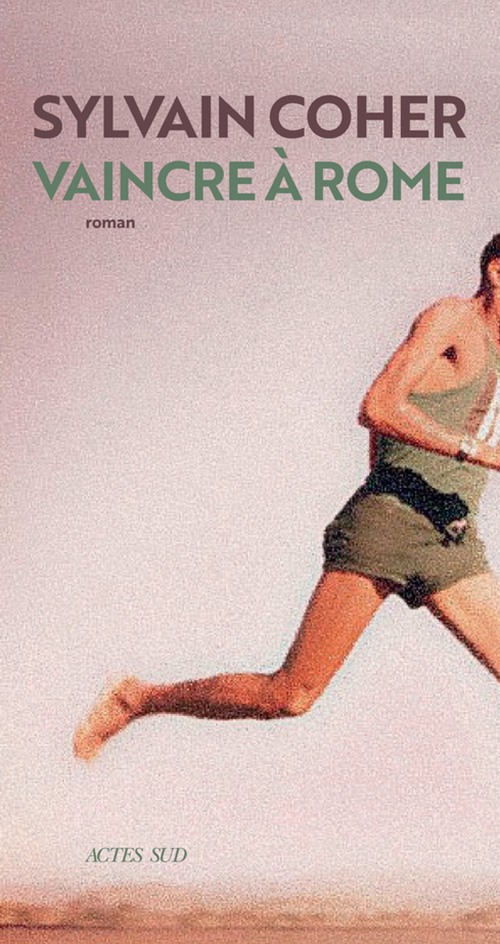
Comme dans n’importe quel esprit en ébullition, boosté ici par la pression et les endorphines, les pensées s’enchaînent, sans qu’elles soient toujours reliées entre elles, au risque parfois de perdre ou de lasser le lecteur.
Le procédé permet néanmoins d’accéder à des bribes de vie du fils de berger devenu soldat. Les montagnes éthiopiennes jaillissent ; on croise la jeune épouse, Yewebdar, qui attend patiemment le retour du bien-aimé ; on y rencontre aussi le « Lion Conquérant », l’empereur éthiopien Hailé Sélassié.
Cependant, c’est bien sûr l’épreuve olympique, ce «combat qui a tout d’une débandade», qui prévaut ici. Abebe Bikila a préparé minutieusement le parcours avec son entraîneur et père de substitution, le major suédois Onni Niskanen.
Le dopage, pratique présentée comme habituelle, est également passé par là. Rien ne surprend jamais l’athlète, des vingt premières minutes, « les plus dures », au « Mur » qu’il faut surmonter entre les kilomètres 30 à 40, alors que le corps ne semble plus pouvoir résister. Même le concurrent au mystérieux dossard 185, qui accompagne l’Éthiopien jusqu’aux derniers kilomètres, n’y pourra rien.
De manière astucieuse, Sylvain Coher a glissé entre les pensées romancées du coureur quelques extraits de la retransmission du marathon sur Radio Inter, en France. Elle offre des respirations bienvenues, tout en permettant de saisir la sidération du monde occidental face à l’exploit d’un quasi-inconnu africain.
Ces mêmes journalistes comprennent sans doute peu l’incroyable symbole que représente la victoire du dossard 11 à Rome, 25 ans après l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie fasciste.
En ce dernier jour du calendrier éthiopien, Bikila produit son effort final en passant devant l’obélisque d’Aksoum, volé par les hommes de Mussolini (et restitué en 2005 à l’Éthiopie). Il franchit la ligne d’arrivée sous l’Arc de Constantin, là où les troupes italiennes étaient passées avant de s’en aller conquérir ce qu’elles estimaient revenir de plein droit à Rome.
« Voici venir la revanche de la civilisation sur la barbarie », fait dire Sylvain Coher à son héros sur le point de triompher. Si le style lyrique du romancier empêche de se croire véritablement dans l’esprit de l’athlète éthiopien, l’écrivain français a le grand mérite de rappeler un moment majeur dans le sport africain et dans l’histoire olympique.
Surtout, il met de l’avant un immense marathonien au destin unique. Après avoir vaincu à Rome, Abebe Bikila remportera de nouveau la médaille d’or aux JO de Tokyo, en 1964. Il mourra en 1971, deux ans après un accident de voiture qui lui a fait perdre l’usage de ses jambes.