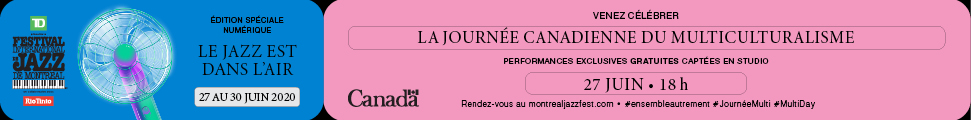Avec La vie lente, Abdellah Taïa se place dans la lignée de son précédent roman, Celui qui est digne d’être aimé (2017) : un récit qui tourne autour d’un homme maghrébin de 40 ans; la description d’un quotidien parisien misérable de solitude et empoisonné par le racisme; l’évocation de multiples destins empreints de détresse.
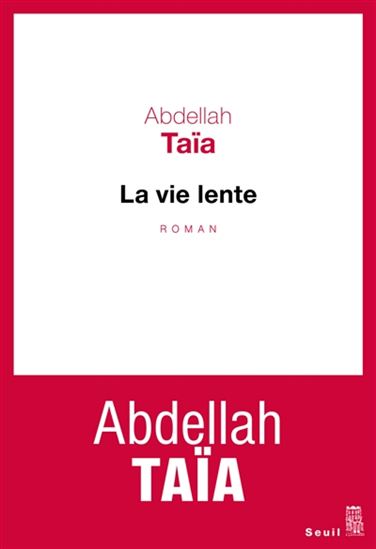
Parmi ceux-ci, se trouve d’abord l’histoire de Mounir, Marocain parti en France pour une vie meilleure. Plusieurs décennies plus tard, malgré des études brillantes et une intégration techniquement réussie, il se trouve au bord de l’abîme, dans son appartement d’un beau quartier de la capitale française. Le pas fatal pourrait prendre la forme d’une ultime dispute avec sa vieille voisine, accusée de faire trop de bruit.
La querelle de voisinage entraîne l’arrivée d’agents de police qui se méfient rapidement de ce quarantenaire arabe. Surtout, elle emporte Mounir dans un monologue où il retrace son enfance (faites de viols par des hommes), ses amours déçus, son identité perdue, ses troubles psychologiques, son immense colère contre la vie, lui-même et les autres.
Ses errements servent de prétexte pour évoquer d’autres existences. Là encore, les esprits sont perclus de coups infligés par la vie. Madame Marty, la voisine bruyante, ne se remet pas de la disparition de sa sœur à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Majdouline, la jeune cousine de Mounir, appelle à l’aide, alors que sa mère (elle-même en plein désarroi) veut la marier de force.
La vie lente raconte d’abord la douleur d’exister et l’impuissance qui en résulte. Les blessures infligées par le déracinement et le rejet de l’autre paraissent trop profondes pour espérer un futur meilleur pour chacun des personnages. C’est aussi implacable que saisissant.
Pourtant, quelque chose ne prend pas, sans doute parce que, peu à peu, Abdellah Taïa perd le fil de son histoire, s’éparpillant dans sa dénonciation des malheurs humains.
Si l’émotion liée au désespoir de ses personnages parvient à toucher, elle ne le fait que trop rarement, du fait d’un pathos imposé à gros traits et d’excès (dont un très hasardeux parallèle entre les nazis et les policiers français d’aujourd’hui). Ce qui devrait intriguer, voire prendre aux tripes, finit, hélas, par lasser. On en sort frustré pour Mounir, Majdouline et les autres.